
Terroirs

Terroirs
Par Camille Bernard – Photographs : courtesy of the estates, le 25 août 2025
On les imagine pâles, secs et fruités. Pourtant, les vins rosés de Provence sont pluriels. En moins de cent kilomètres, la nature des sols est totalement différente : ici, des rhyolites pourpres ; là, des schistes bleutés ; plus loin, des marnes argilo calcaires. Cette pluralité compose un archipel de terroirs où l’on ne produit pas un rosé, mais des rosés.
Que reste‑t‑il du cliché d’un rosé de Provence léger, consommé glacé dès le printemps ? Peu de chose, si l’on se fie à la nouvelle garde des vignerons et aux coopératives rajeunies qui sillonnent l’arc méditerranéen. Car la Provence viticole est une diagonale de microclimats : influences maritimes au sud‑est, davantage continentales autour d’Aix ; amplitude thermique dans les gravités fraîches de la Trevaresse ; brise matinale sur les schistes des Maures. À ces climats se superposent des géologies contrastées : la chaîne de la Trevaresse, petit Jura provençal hérissé de calcaires blancs ; le bassin de l’Arc, patchwork de marnes et de sables ; l’Estérel, massif volcanique rouge sang qui plonge dans la Méditerranée ; enfin, les Maures, ruban de schistes miroitants. Entre 50 et 400 mètres d’altitude, la vigne s’accroche à des terrasses, se love dans des combes, prend le mistral de face ou s’abrite dans une pinède.
À l’échelle du vignoble, ce "mille‑feuilles" de sols et de microclimats se traduit par des expressions aromatiques, des textures et des énergies radicalement différentes. Or, depuis quinze ans, une poignée de vignerons – coopératives incluses – a décidé de mettre ces nuances en bouteille, de les raconter plutôt que de les lisser.
Ce dossier s’arrête chez quatre producteurs qui, sans prétendre résumer la Provence, en dessinent les contours : Les Quatre Tours au nord d’Aix, Château Paquette dans le feu de l’Estérel, Domaine Rostangue sur les phyllades de Pierrefeu‑du‑Var et Domaine des Thermes au pied des Maures. Quatre points cardinaux, quatre philosophies, un même mot d’ordre : le terroir d’abord.

Sur les flancs calcaires de la Trevaresse, la coopérative Les Quatre Tours cultive 370 hectares
À Venelles, la cave coopérative Les Quatre Tours cultive depuis toujours la devise "l’union fait la force" mais la force a changé de visage. Sous l’impulsion de Thierry Blanchard au tournant des années 2000, puis de Gilles François aujourd’hui, les 39 adhérents ont troqué l’anonymat du vrac pour créer une large gamme de cuvées judicieusement segmentées. "Nous sommes là où on ne nous attend pas", sourit Gilles François, directeur général.
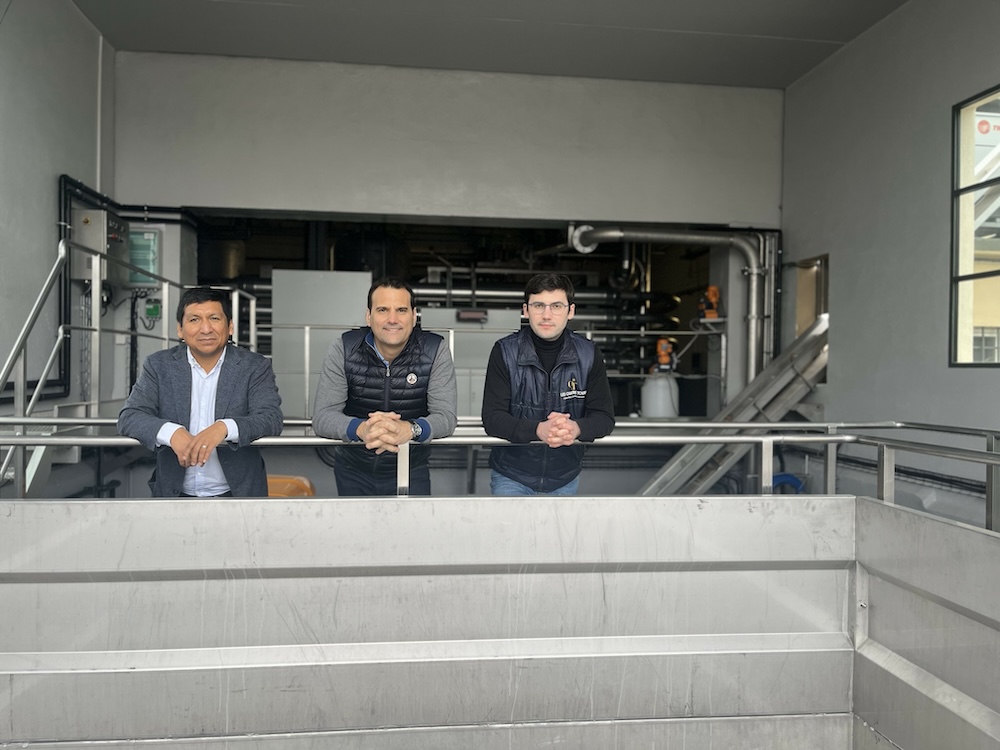
De gauche à droite, Illia Domanchuk, directeur technique ; Vincent Royere, président, et Gilles François, directeur général
Clef de voute d'une telle diversité : "un approvisionnement de 370 hectares disséminés entre Venelles, Coutheron, Lambesc, Éguilles et Le Puy‑Sainte‑Réparade, sur les flancs de la Trevaresse, entre 200 et 400 mètres d'altitude", précise-t-il.
À Lambesc, un filon basaltique confère à quelques rangs une énergie tellurique inattendue ; à Coutheron, un socle granitique évoque les contreforts alpins ; plus bas, les marnes argilo‑calcaires portent une vigne qui produit des vins d'une grande finesse.
Pour canaliser tant de diversité, la coopérative s'appuie sur son directeur de vignoble. Véritable chef d’orchestre, il parcourt les parcelles, traque les maturités physiologiques, planifie les vendanges pour préserver la tension.

À Venelles, la boutique de la cave des Quatre Tours attire aussi bien les habitants que les vacanciers de passage
Côté cave, un quai de réception flambant neuf trie les baies et un circuit de refroidissement façonne des rosés aux arômes de thiols dosés, jamais tapageurs. "Le plus gros travail est fait avant la vendange", insiste le directeur général.
Résultat : des rosés de terroir qui n’ont pas peur de l’acidité vraie.
La gamme s’organise comme un éventail gradué : rosés plaisir pour la grande distribution, cuvées premium pour la restauration, et, au sommet, les sélections cadastrées Bec et La Colline, sans oublier Vilandria.

La cave des Quatre Tours a délimité des parcelles précises : à gauche, Les Gailles, et à droite, Bec.
Les Quatre Tours prouvent ainsi qu’une coopérative peut conjuguer volumes et vins de terroir. Un modèle dont s’inspirent d'ailleurs plusieurs unions voisines.
À Fréjus, le vert des pinèdes cède au rouge brique des rhyolites qui forment l’ossature du massif de l’Estérel. C’est là qu’en 1952 Marcel et Gilberte Paquette ont posé leurs valises ; leur fils Jean Paquette mènera ensuite un long combat avec l’INAO pour faire reconnaître la singularité de ces sols volcano‑sédimentaires. Ses efforts aboutissent en 2005 avec la naissance de la dénomination Côtes‑de‑Provence Fréjus, petite enclave au sein de la grande AOC, où la roche issue du Permien règne sans partage.

Jérôme Paquette, 3ème génération du domaine familial
"Nous sommes sur un vignoble relativement homogène qui se distingue par une géologie marquée par des sols volcano-sédimentaires", explique Jérôme Paquette, vigneron et œnologue consultant pour d'autres domaines de la région. "Ces sols volcaniques donnent vraiment leur signature aux vins de l'AOC Côtes de Provence Fréjus. Ce sont des vins marqués par la fraîcheur mais avec peu d'acidité. Ils ont de la rondeur sans être moelleux", ajoute ce dernier.
Depuis qu'il a repris le domaine familial en 2004, il pousse la production de vins de terroir jusqu’à son paroxysme : certification biologique dès 2014, passage à la biodynamie l’an dernier et, surtout, "vinifications parcellaire pour révéler au mieux le terroir", explique ce dernier.

Fleuron de l'AOC Côtes de Provence Fréjus, Château Paquette revendique des rosés de terroir

Le Château Paquette est l’un des fleurons de l’AOC Côtes de Provence Fréjus
Ici, pas de marathon pour extraire les thiols : "Je revendique un rosé de terroir, pas un rosé technologique", répète le vigneron. Les raisins, vendangés à la fraîche, sont vinifiés selon les règles de l’art : "Chez moi, la vinification se fait pour sortir un vin qui se mange, avec des arômes délicats et complexes. Un vin doit avoir de la bouche, de la sapidité. Je ne sulfite pas durant les fermentations. Je préfère laisser les choses se faire naturellement. On laisse sur lies jusqu'en janvier."
Trois cuvées illustrent ce credo : Château Paquette, porte d'entrée des vins du domaine, à boire dans sa jeunesse ; Angelico, qui affiche un potentiel de garde de 3 à 4 ans ; et Thémis, "une allégorie du terroir en termes de balance et d'équilibre".
Membre de l'Association Internationale des Rosés de Terroirs (AIRT), le vigneron prône la garde : "C'est important pour moi d'offrir des vins surprenants en matière de capacité de vieillissement. La garde exprime tellement mieux la typicité de nos terroirs."

Au pied des Maures, le vignoble du Domaine Rostangue est cerné par la garrigue
À la lisière ouest du massif des Maures, Jean‑Charles Buffet cultive dix hectares en terrasses, cernés de garrigue et de chênes‑lièges, "sur un tapis de schistes appelés ici phyllades bleues du Réal Martin", précise ce dernier.

Jean-Charles Buffet s'emploie depuis 15 ans à créer des vins de terroir
Les rangs, difficiles d’accès, obligent à travailler à la charrue ou à la pioche ; les pierres, coupantes, brisent les outils ; les rendements sont parmi les plus faibles de la région. Cultivées en agriculture biologique depuis quinze ans, les vignes sont désherbées manuellement. Mais le vigneron n’abandonnerait pour rien au monde cette rudesse : "Ces sols pauvre sont très difficiles à travailler mais ils sont propices à l’élaboration de vins de qualité car les vignes s'enracinent profondément et cela permet aux raisins de développer des arômes complexes."
Rosé d’apéritif ou rosé gastronomique ? Le vigneron assume les deux, mais réserve ses plus beaux grenaches, mourvèdres et cinsaults à un lot parcellaire assemblé en novembre. Les vieilles vignes – parfois plus de 50 ans – dictent leurs rythmes. "Suivant les terroirs, les rosés peuvent et doivent se garder" martèle‑t‑il, convaincu que la Provence a plus à offrir qu’une robe pâle et une buvabilité estivale.

À Pierrefeu-du-Var, Jean-Charles Buffet cultive ses vignobles en agriculture biologique

Le Domaine des Thermes, propriété historique de l'AOC Côtes de Provence

Le Domaine des Thermes dispose d’installations modernes de vinification et produit des rosés vifs, précis et aromatiques
À Vidauban, la famille Robert veille sur quarante‑cinq hectares depuis le XVIIIe siècle, mais les Romains les avaient précédés de 2000 ans. Dans le caveau, stèles funéraires et amphores rappellent cet héritage ; le nom même du domaine provient d’une villa dotée de thermes, fouillée non loin. Le terroir, argilo‑calcaire caillouteux, se divise en deux : coteaux ventilés (18 ha) et plaines d’argiles rouges (25 ha). Olivier s’occupe des vignes, Sylvain de la cave, Michel – le père – taille encore les vieilles syrahs.

À la cave, Sylvain Robert orchestre une vinification millimétrée
"Le rosé est un vin d’assemblage", affirme Sylvain, qui vinifie les vins de la propriété familiale depuis 25 ans. Pour y parvenir, vingt cuves accueillent autant de micro‑lots qui, une fois assemblés, produisent 4 rosés dont 1 en IGP Var et 3 en AOC Côtes de Provence.
"En plaine, les argiles rouges forgent des jus de caractère avec beaucoup de finesse ; sur les coteaux, le calcaire signe la fraîcheur de nos vins", précise ce dernier.
Premier millésime embouteillé en 1999, premières récompenses récoltées… et, depuis lors, le même souhait : "produire des rosés vifs et aromatiques représentatifs de leur terroir", conclut le vigneron.
Du rosé d'apéritif au rosé gastronomique, la Provence offre une diversité de styles aussi riche que ses terroirs.

Avec de l’argile rouge dans le fond de la vallée et du calcaire sur les collines, Vibaudan, comme partout ailleurs en Provence, bénéficie d’une incroyable diversité géologique
Du massif volcanique de l’Estérel aux schistes bleutés des Maures, des terrasses caillouteuses d’Aix aux coteaux calcaires du Var, la Provence dévoile un chapelet de terroirs que rien ne rapproche… sinon la recherche d’un rosé identitaire. Coopérative ou domaine familial, tous partagent la conviction que le sol vaut bien le cépage et que la garde, notion longtemps bannie du lexique rosé, n'est plus un tabou, bien au contraire.
Rosé plaisir et rosé gastronomique se complètent enfin. La Provence, longtemps accusée d’uniformité, s’aventure enfin dans la cartographie fine. Ce n’est plus un vignoble ; c’est un archipel. À chacun désormais de déguster ce que la couleur seule ne révèle pas : la verticale invisible du terroir.

Terroirs

Terroirs

Terroirs